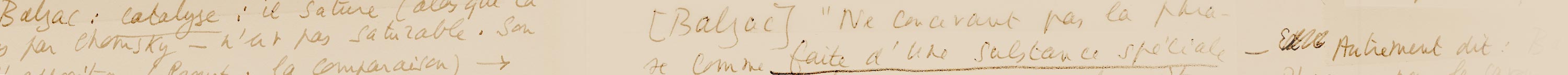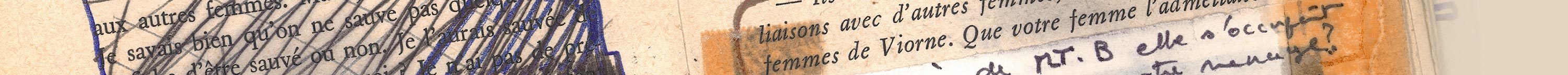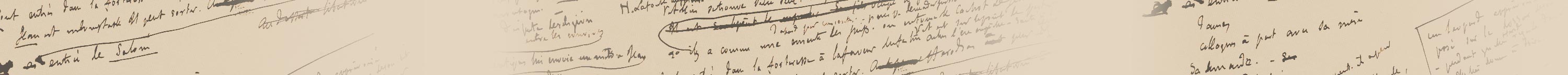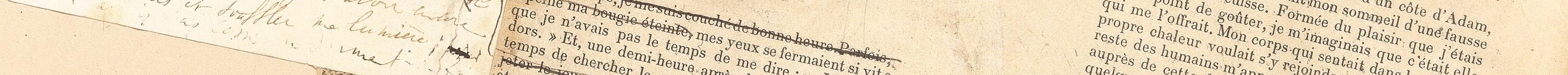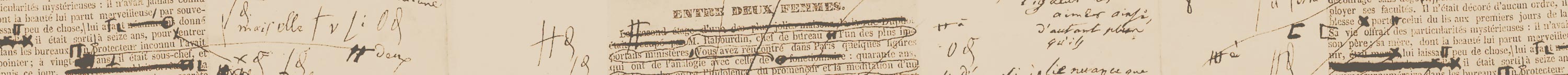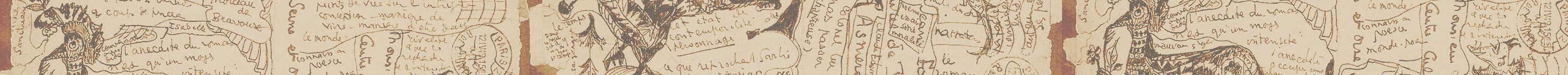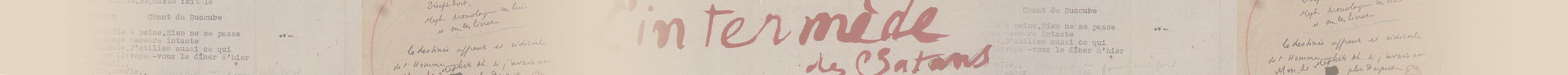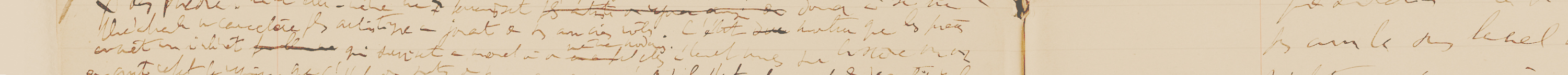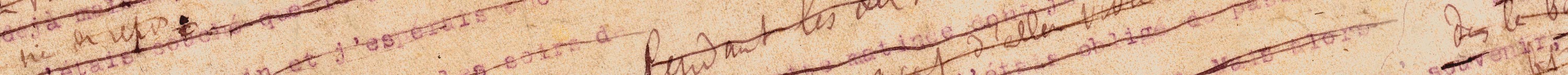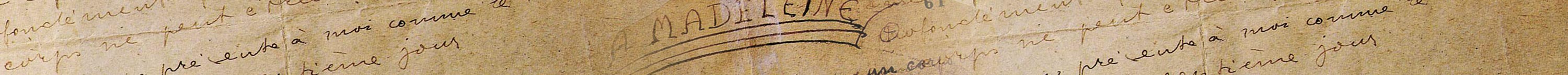Séminaire :
Séminaire manuscrits scientifiques / 2024-202514/04/2025, ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Ferdinand Berthier (U207), 14h-17h

Dessin de Mme Lavoisier, conservé à la Wellcome Library de Londres (reproduction libre).
Karine Chemla (School of Mathematics, The University of Edinburgh, & SPHERE, CNRS-UPC) et Bruno Belhoste (IHMC, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) – Qu’est-ce qui est en jeu dans les manuscrits de Jean-Victor Poncelet ?
À la fin de sa vie, entre 1862 et 1866, Jean-Victor Poncelet éprouve le besoin de publier les archives qui documentent son travail de géométrie dans les années 1810-1830. Les historiens se sont pour l’essentiel appuyés sur ces publications pour étudier l’évolution des réflexions qui ont mené à la publication du Traité des Propriétés projectives des figures de 1822. Néanmoins, une question clef n’a pas encore été vraiment traitée : comment Poncelet a-t-il publié ses archives à la fin de sa vie ? Les manuscrits conservés donnent quelques réponses. Ils documentent également le travail du jeune Poncelet et posent une seconde question qui conditionne la réponse à la première : comment Poncelet a-t-il travaillé avec ses notes dans la période qui précède la publication du traité aussi que dans celle qui mènera aux ouvrages des années 1860 ? Notre exposé montrera comment certains de ces documents présentent différentes strates temporelles qu’il est essentiel d’apprendre à distinguer pour traiter les deux questions posées.
Francesca Antonelli (Università di Bologna) – Une archive, plusieurs mains. Matérialité, sociabilité et genre dans les papiers de travail de Lavoisier (années 1770-1830)
Un carnet de laboratoire du XVIIIe siècle : de quoi est-il la source ? Dans cette présentation, nous proposons de revenir sur les papiers de travail du chimiste français Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) afin de montrer comment ses registres de laboratoire et ses carnets de voyage peuvent servir pour une histoire sociale et genrée des sciences au XVIIIe siècle. Notre point de départ sera la présence, au fil de ces papiers, de la main de plusieurs collaborateurs de Lavoisier et notamment son épouse, Marie-Anne Paulze-Lavoisier (1758-1836) qui se charge de leur rédaction depuis peu après son mariage avec le chimiste en 1771.
Par le biais d’une approche attentive à la matérialité du document, et non seulement à ses contenus, nous verrons que ce que l’on considère aujourd’hui comme l’ « archive de Lavoisier » est en réalité le produit d’un travail collectif. Nous pourrons ensuite montrer que ces carnets, dont le style est souvent technique et peu narratif, peuvent en réalité constituer une source extrêmement riche pour reconstituer les dynamiques collaboratives et les hiérarchies sociales (et genrées) au sein d’un laboratoire du XVIIIe siècle, ainsi que pour retracer les trajectoires de Marie-Anne Paulze-Lavoisier (et, dans une moindre mesure, de certains collaborateurs masculins) entre Lumières et Restauration.