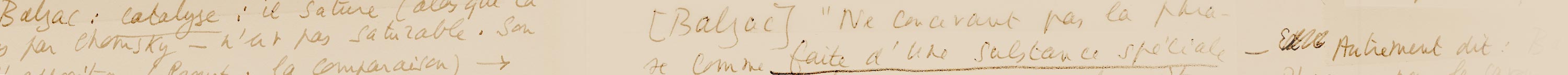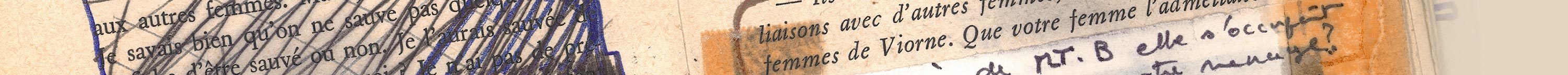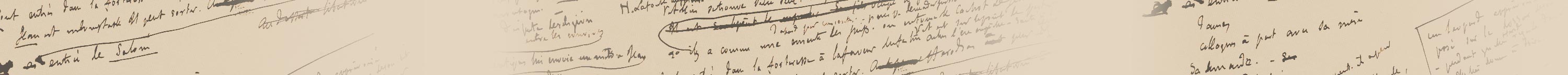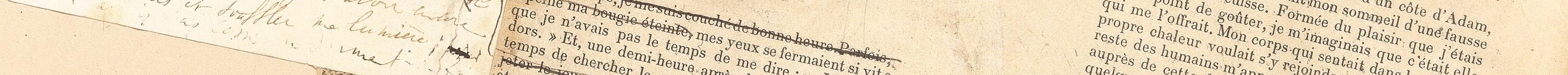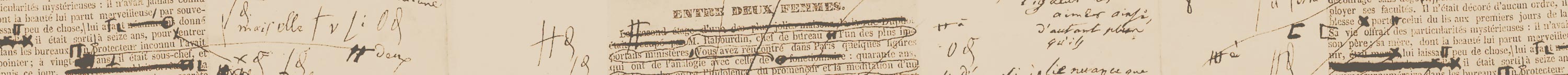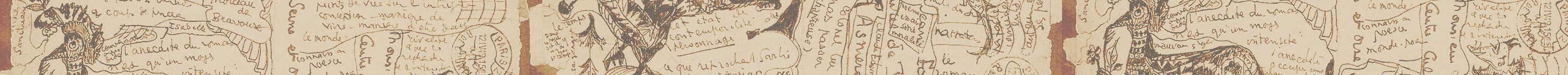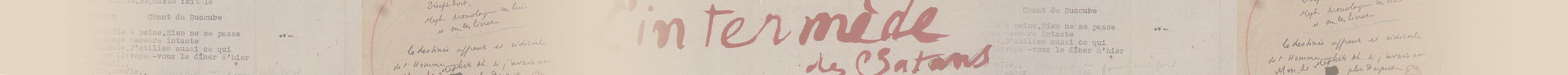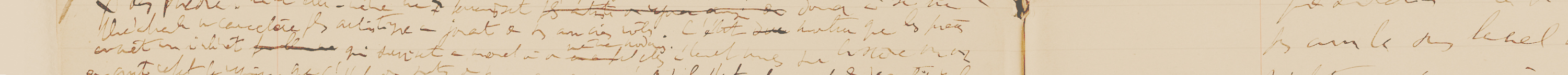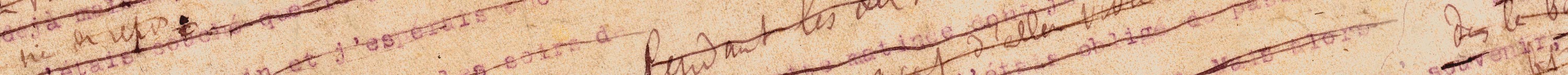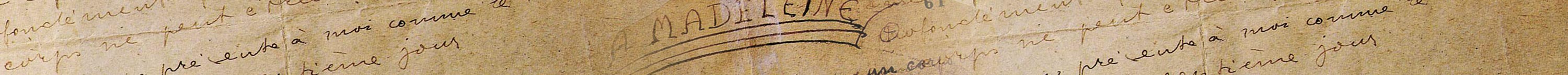Séminaire :
Séminaire Schwarz-Bart / 2024-202530/04/2025, En visioconférence, 14h-16h (lien disponible sur demande)
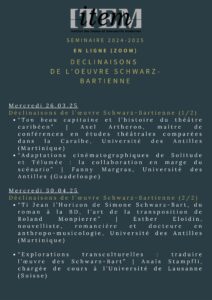 Déclinaisons de l’œuvre Schwarz-Bartienne 2/2
Déclinaisons de l’œuvre Schwarz-Bartienne 2/2“Explorations transculturelles : traduire l’œuvre des Schwarz-Bart” | Anaïs Stampfli, chargée de cours à l’Université de Lausanne (Suisse)
Séminaire en ligne (lien zoom sur demande à Fanny Margras <margras.fanny@gmail.com>)
Imaginer ce récit aux multiples ramifications et diverses intrigues croisées dans un album sans en faire un fade résumé relevait d’une vraie gageure : Simone Schwarz-Bart, ardente défenderesse de la transmission, est activement impliquée dans ce travail de réécriture. Elle accepte volontiers de sacrifier une grande partie de son roman au profit d’une transposition subtile à un nouveau médium. Cette communication analysera le pouvoir évocateur du dessin de Roland Monpierre qui donne à redécouvrir l’histoire de Ti-Jean L’Horizon à travers une sélection d’instants chargés, denses et épiques qui a su gagné les faveurs d’un plus large lectorat. Reste-t-il de l’ouvrage l’essence de l’histoire et un concentré de situations intenses mêlant rites magiques à la science-fiction ? »
Doctorante en anthropo-musicologie à l’Université des Antilles, Esther Eloidin est aussi auteure-nouvelliste et romancière. Anciennement professeur-documentaliste, professeur d’éducation musicale et de chant choral dans le secondaire et directrice d’un centre des arts et du spectacle dans le nord de la Martinique, elle est aussi animatrice et journaliste radio. Son domaine de recherche concerne les textes de chansons grivoises antillaises sur lesquels elle s’appuie pour analyser l’évolution de la société antillaise. Elle a publié ‘Biguine d’amour’ : l’intermélodicité ‘récituelle’ dans La Mulâtresse Solitude (2021) ; Quatre siècles de chansons grivoises et paillardes aux Antilles-Guyane (2021) et Papy Héloise, Un artiste aux multiples facettes suite à un travail de collecte incluant un recueil de partitions d’un musicien de guitare hawaïenne, Lunel Héloise (2004). En 2003, elle a soutenu son mémoire « La haute taille : tradition musicale rurale du sud de la Martinique » à l’université de Nice Sophia Antipolis.
Il sera ici question des raisons pour lesquelles on peut envisager la traduction des œuvres d’André et Simone Schwarz-Bart comme un vecteur de liens transculturels. Cet article propose une réflexion d’ensemble sur les quatre apports majeurs des traducteurs des œuvres des époux Schwarz-Bart issues de ce que l’on nomme le cycle antillais. Après avoir évoqué la particularité du style des récits d’André et Simone Schwarz-Bart, nous verrons que la traduction permet de mettre en lumière la genèse des œuvres sources tout en se faisant elle-même espace de recréation, support de réflexion sur les liens entre les langues et moyen de penser ensemble différents espaces géographiques.